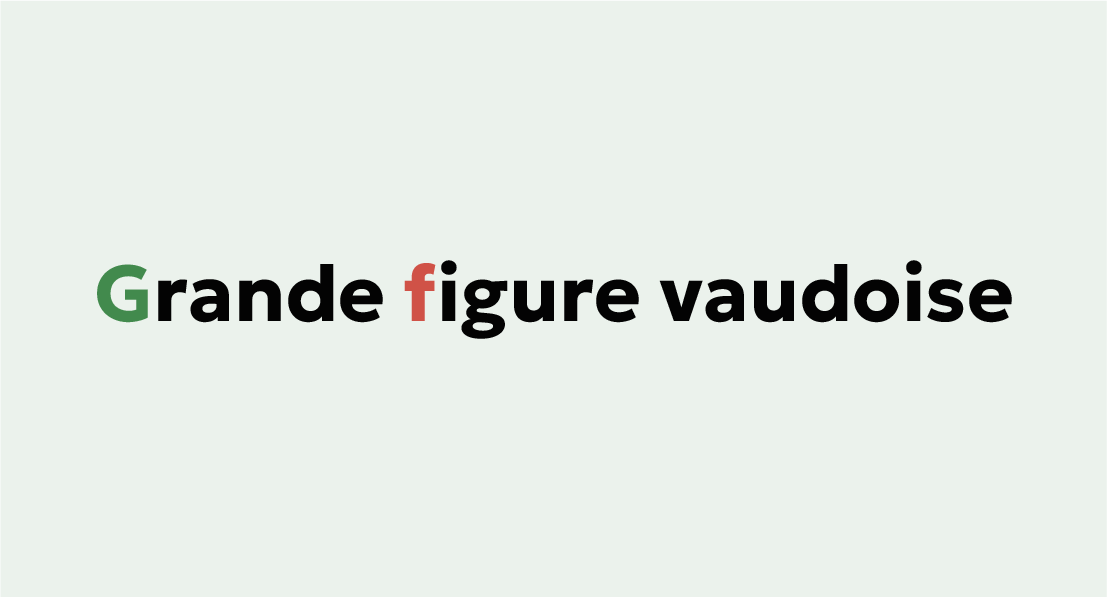
Victor Ruffy (1823-1869)
Grandes figures vaudoises
Né en 1823 à Lutry, Victor Rufy étudie le doit à Lausanne, où il entre à Zofingue, et Heidelberg. Comme les autres jeunes Zofingiens d’alors qui se sentaient proches des idéaux radicaux, Leresche, Bonjour, Meystre ou encore Eytel, il ne défend pas une scission au sein de la société vaudoise. Contrairement à ce qu’avaient décidé les Lucernois et les Zurichois, fondateurs de l’Helvétia suisse en 1832, la section vaudoise de Zofingue caresse encore l’espoir de réunir sous le même étendard l’ensemble des étudiants suisses et fustige l’attitude des dissidents. En 1848 d’ailleurs, la fondation de la section vaudoise de l’Helvétia ne sera nullement le fait de Zofingiens désireux de rompre avec une société qui avait renoncé depuis longtemps à tout engagement politique, mais de quatre jeunes Vaudois, aidés de trois étudiants d’autres cantons, qui souhaitaient vivre leur foi radicale dans une société nouvelle et indépendante.
Avocat, élu au Tribunal cantonal alors qu’il n’a pas encore atteint les 25 ans requis, ce qui obligera la Grand Conseil à répéter l’opération quelques semaines plus tard, une fois ce seuil franchi par l’impétrant, Ruffy n’ambitionne rien de plus qu’une carrière tranquille dans la magistrature. La politique le rattrape toutefois, dès 1858, lorsque les électeurs de sa région l’envoient à Berne, au Conseil national. Il quitte alors ses fonctions judiciaires. L’année suivante, il est élu au Grand Conseil et le jour de son assermentation, au Conseil d’Etat. Habilement, il parvient à se dérober. Certes, ses aspirations personnelles, ses charges de famille l’incitent plutôt à fuir les honneurs. Mais, proche de Delarageaz, il sait aussi que son gouvernement est sur le point de s’écrouler, sourd qu’il est aux revendications de l’opposition de gauche et des libéraux. Avec son éviction du Conseil national en 1860, il expérimente personnellement la lassitude des Vaudois et l’épuisement du radicalisme gouvernemental, qui s’accroche au pouvoir depuis 1845.
Elu à l’Assemblée constituante de 1861, il subit à nouveau les contre-coups de son appartenance au clan Delarageaz lors des élections générales de 1862. Dans un cercle tenu par les alliés libéraux et radicaux de gauche, les vainqueurs de 1862, il échoue aux élections au Grand Conseil, malgré son succès de 1861, qui l’avait vu retourner à Berne. Desservi par son opposition, avec Delarageaz, à une loi sur les incompatibilités qui avait fortement entaillé le pouvoir radical au Grand Conseil, il avait surtout payé son affiliation à une mouvance maintenant en disgrâce. Il faudra une élection partielle à Rougemont quelques mois plus tard pour que, une fois les réseaux de Delarageaz réorganisés, Ruffy récupère son siège. A partir de 1864, il officie également comme juge fédéral et, à ce titre, il aura la lourde tâche de présider les assises fédérales chargées de juger les responsables des débordements violents survenus lors des élections cantonales de Genève, en mai 1864.
A Lausanne, c’est par lui que les radicaux de Delarageaz, exclus du Conseil d’Etat en 1862, vont amorcer leur reconquête. En 1863, pour contrer son ennemi Eytel, qui vient de démissionner et qui compte bien être réélu sur le champ par le Grand Conseil, Delarageaz, qui ne supporte pas de se retrouver comme simple député, parvient à convaincre celui qui avait refusé de rejoindre son gouvernement trois ans auparavant. Apprécié sur toutes les travées de l’hémicycle, Victor Ruffy est brillamment élu. Dès lors, avec l’aide de Louis Ruchonnet, un autre protégé de Delarageaz, il reconstruit pas à pas le parti radical, avec une série de jeunes députés non compromis avec l’équipe précédente. Le retour de Delarageaz au Conseil d’Etat en 1866 ne freinera pas leurs efforts. Les deux hommes vont au contraire s’émanciper de leur mentor, rassemblant progressivement autour d’eux toutes les forces radicales, jeunes et anciennes.
Commandant d’un bataillon de chasseurs jouissant d’une solide réputation dans le canton, botaniste passionné, poète connu pour sa Géographie du canton de Vaud, membre du comité de la Société de secours mutuels depuis 1860, il s’installe avec un sens du devoir aguerri au sein du collège gouvernemental. Il prend en charge le Département de l’instruction publique et des cultes et emmanche une vaste réforme de l’enseignement primaire que Ruchonnet, qui lui succédera à ce poste, aura pour mission de défendre au Grand Conseil, en 1868. A peine confronté aux réalités gouvernementales vaudoises, le destin vient toutefois à nouveau le chercher pour un poste qu’il ne souhaitait pas. En 1867, Constant Fornerod démissionne du Conseil fédéral pour rallier le monde des affaires, qui provoqueront quelques années plus tard sa ruine.
Victor Ruffy est immédiatement sollicité pour ce siège devenu vacant. Hésitant, mais semble-t-il convaincu par Louis Ruchonnet, il s’embarque pour Berne, malgré une santé chancelante. Il reçoit le Département des finances. Il aura l’occasion de mettre en place un dispositif législatif qui devait inciter certains cantons récalcitrants à supprimer tout obstacle au droit au mariage et que Ruchonnet pourra reprendre pour lancer sa propre motion, à la base du processus révisionniste concrétisé par le projet de Constitution de 1872. Mais en décembre 1869, alors qu’il vient d’être élu président de la Confédération pour l’année suivante, après une soirée entre amis, dont Ruchonnet, où il avait laissé transpirer une mélancolie suspecte, il s’effondre et décède peu après.
© Olivier Meuwly, Lausanne 2003