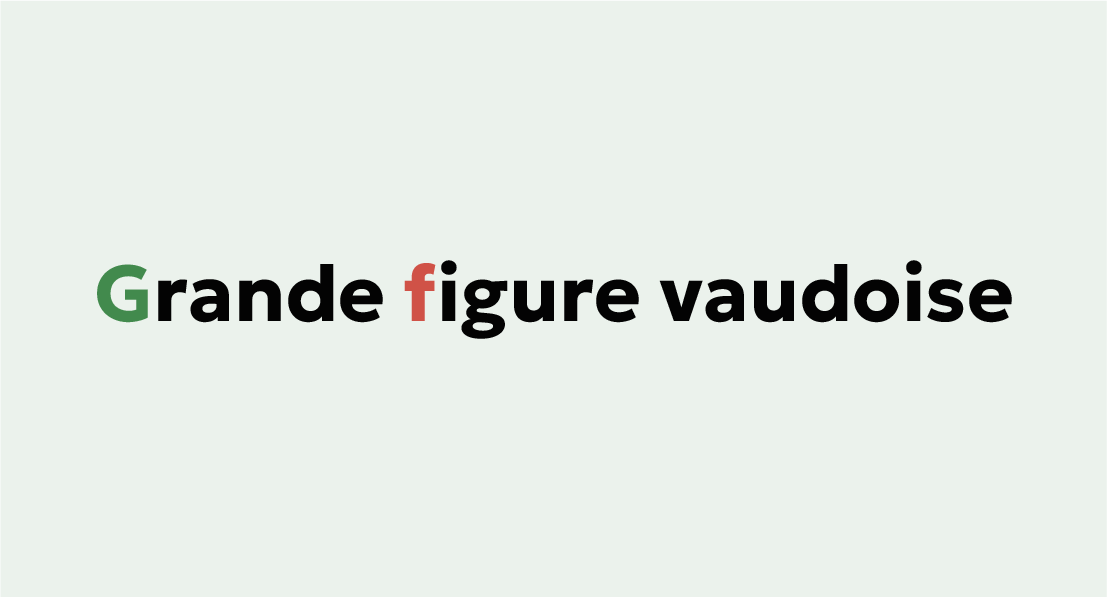
Ernest Chuard (1857-1942)
Grandes figures vaudoises
Né en 1857 à Corcelles-près-Payerne, Ernest Chuard est issu d’une famille de politiciens. Son père, Jean-Louis est conseiller d’Etat, puis préfet de Payerne, et son beau-frère, Ernest Rubattel sera conseiller national, conseiller d’Etat et père du conseiller fédéral Rodolphe Rubattel… Le jeune Chuard a toutefois d’autres ambitions. Après des études d’ingénieur chimiste à l’Académie de Lausanne, où il entre à Helvétia, et à Würzburg, il compte se consacrer à l’enseignement et la recherche.
En 1882, il est professeur de physique à l’Ecole industrielle; en 1884, professeur de chimie au Gymnase cantonal et à l’Ecole cantonale d’agriculture, puis d’histoire et de chimie à l’Ecole de pharmacie. En même temps, il enseigne la chimie analytique et la chimie agricole à l’Académie, tâches qu’il poursuivra une fois l’Académie transformée en Université. Il est doyen de la Faculté des sciences de 1894 à 1896. Directeur de la station viticole de Lausanne, puis de l’Ecole d’agriculture du Champ-de-l’Air à Lausanne, il s’engage pour la modernisation de l’agriculture et est à l’origine de nombreuses coopératives agricoles et viticoles. Membre du Conseil de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich en 1907, il entre au comité de l’Union suisse des paysans puis, également en 1907, en devient vice-président. Il sera nommé docteur honoris causa des Universités de Lausanne et Zurich, ainsi que de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich.
Colonel, il n’entame une carrière politique que tardivement, en marge de ses activités scientifiques. Comme nombre de jeunes Helvétiens, il a subi l’influence de Ruchonnet et, plus tard, reconnaîtra publiquement sa dette envers lui. Conseiller communal à Lausanne, il préside ce corps en 1894. Il n’entre au Conseil national qu’en 1907, pour succéder à son beau-frère. En 1909, il s’assied sur le siège parlementaire de Camille Decoppet, élu au Conseil d’Etat, puis est élu au conseil d’Etat en 1912. Apprécié pour ses qualités de conciliateur, adulé par le monde paysan dont il est si proche, il ne peut résister aux appels de ses coreligionnaires. Sa disponibilité est en effet vitale pour son parti. Depuis peu, les agriculteurs vaudois se sentent laissés pour compte et songent de plus en plus à s’organiser en marge des partis qui dominent depuis longtemps la scène politique vaudoise. Il est nécessaire d’agir, car l’agriculture emploie encore près du quart de la population active du canton.
Pour Chuard, les velléités sécessionnistes sont inacceptables. Il est impératif de montrer aux paysans que leur vraie famille est le parti radical, appuyé au niveau associatif par l’Union suisse des paysans et son pendant vaudois. Son engagement tardif en politique illustre cette conviction. Mais le combat s’annonce rude, car la paysannerie vaudoise fait montre d’une forte détermination. Aussi, lorsque son collaborateur Ferdinand Porchet présentera en mars 1919 son rapport, commandité par la Société vaudoise d’agriculture et de viticulture, sur l’opportunité de créer, ou non, un parti propre aux paysans, Chuard n’hésitera-t-il pas à soutenir avec force les conclusions de son futur dauphin au gouvernement, des conclusions déconseillant le monde agricole de divorcer des partis politiques classiques.
Au Château, il dirige le Département de l’instruction publique et des cultes et s’occupe personnellement de la révision de la loi sur l’Université. La légende rapporte qu’il avait rédigé lui-même le projet de loi en deux jours… En 1917, il hérite du Département de l’agriculture, de l’industrie et du commerce, où ses compétences largement reconnues en matière agricole vont faire merveille. Il aura la lourde responsabilité d’assurer l’approvisionnement du canton durant la Grande Guerre. Son talent de conciliateur, qu’il exerce avec bonheur dans le canton de Vaud, cimente également sa réputation à Berne… pour son plus grand malheur cette fois.
A la fin de l’année 1919, le siège de Camille Decoppet est à repourvoir et les Vaudois entendent bien conserver leur siège au gouvernement fédéral. Un homme s’impose à leurs yeux: le syndic de Lausanne et conseiller national Paul Maillefer. Mais celui-ci a fortement irrité les Alémaniques pendant la guerre par ses discours germanophobes et violemment antisocialistes. Pour eux, il est exclu de donner leurs suffrages à cet homme. Ils ne s’opposent pas à l’élection d’un Vaudois, à la condition cependant que ce se soit Ernest Chuard et personne d’autre. Chuard tente par tous les moyens de convaincre ses collègues de porter leur choix sur Maillefer, mais rien n’y fait. De guerre lasse, il se résigne et, malgré son âge déjà avancé, accepter de déménager à Berne. Bien qu’il ait d’entrée de cause qu’il ne serait qu’un conseiller fédéral de transition, il restera en place huit ans. Il démissionnera en 1928, cédant sa place à Marcel Pilet-Golaz.
Comme conseiller fédéral, il anime pendant tout son « règne » le Département de l’intérieur. Police des eaux, stupéfiants, chasse, protection du gibier et des oiseaux, forêts, tous ces sujets passent par le crible de l’esprit sagace du « conseiller fédéral malgré lui », selon l’expression qui accompagnera son entrée dans l’histoire. Il s’intéressera toutefois particulièrement à la lutte contre la tuberculose et au régime des alcools. A travers ce dernier, il percevait le moyen de débloquer des fonds importants en faveur d’une politique sociale et de la santé plus ambitieuse. Il sera président de la Confédération en 1924.
© Olivier Meuwly, Lausanne 2003