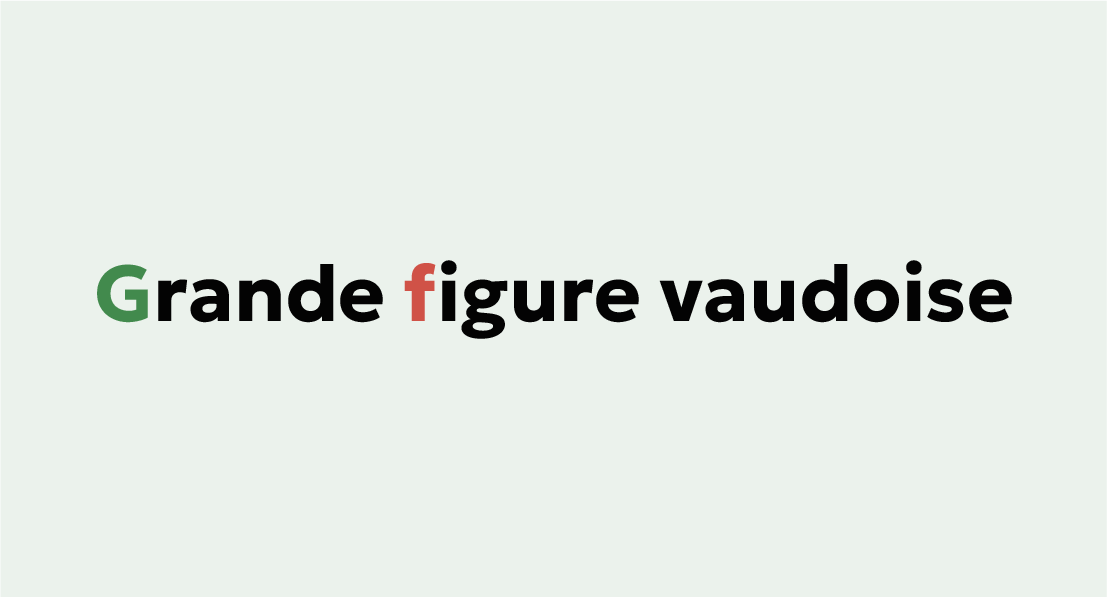
Jean Schopfer (1800-1875)
Grandes figures vaudoises
Né en 1800 à Morges, issu d’un milieu modeste, Schopfer tente jeune sa chance à l’étranger, au Havre. D’une intelligence précoce en affaires, il s’enrichit et revient s’installer dans sa ville d’origine. Rapidement, il s’abouche avec le très actif milieu radical morgien, où l’on repère le tanneur Henri Reymond, le quincailler François Thury, un proche de Delarageaz, ou encore Rodolphe Soutter-Bron. Et, pas loin, œuvre Delarageaz lui-même, depuis son domaine de Préverenges. On retrouve Schopfer parmi les membres de l’Association de sûreté fédérale, berceau du radicalisme suisse, puis au chevet de l’Association patriotique, que fonde Delarageaz. A la veille de la Révolution, Schopfer apparaît comme l’un des orateurs les plus virulents contre le régime conservateur lors des assemblées populaires qui fleurissent alors.
L’extrémisme dont il pare ses discours ne durera pas. Schopfer souhaite un changement de régime en douceur et s’oppose à une Révolution. Désavoué, il fait savoir qu’il ne pourra pas accepter un poste au sein du gouvernement provisoire, comme il en avait été un temps question. C’est d’ailleurs empli d’une modération prononcée qu’il entre au Grand Conseil, en 1845. Son attitude plaît cependant au gros des troupes radicales qui envahissent le Parlement cantonal. Ainsi, lorsque Delarageaz abandonne la présidence du Grand Conseil pour prendre place sur le banc gouvernemental, c’est Schopfer qui est désigné pour lui succéder au « perchoir ». Il symbolisera désormais le radicalisme modéré qui, pas très éloigné des libéraux, caractérise une grande partie des députés campagnards que la Révolution a amenés au Grand Conseil.
Son influence est considérable et trouve un relais important au gouvernement en la personne de Louis Bourgeois, qui lui aussi se distingue par un esprit indépendant et modéré. Sa fortune, sa proximité des libéraux énervent de plus en plus Druey, et les altercations entre les deux hommes se multiplient. Schopfer est néanmoins réélu à la présidence du Parlement en 1846, honneur qu’il refuse toutefois, estimant qu’un politicien ne doit pas s’accrocher au pouvoir, quelle que soit sa forme. C’est l’architecte Louis Wenger qui est élu, mais Schopfer est immédiatement choisi comme second vice-président. Premier vice-président en 1847, il recouvre naturellement son fauteuil présidentiel en 1848. Une violente dispute avec Druey, lors d’un tir cantonal, attise cependant la haine des « drueysiens » à son égard. Accusé d’avoir manœuvré dans le dos du Parlement lors de l’élection des délégués vaudois à la Diète fédérale, il démissionne sur-le-champ. Réélu par son cercle, il regagne triomphalement l’hémicycle, mais a perdu dans l’aventure sa présidence, qui échoit à Eytel.
Schopfer siège au Grand Conseil jusqu’en 1861. Durant ses seize années de politique active, il émerge indiscutablement comme l’un des leaders du radicalisme modéré qui freine l’action de Druey, d’abord, puis du radicalisme « gouvernemental » qu’incarne Delarageaz. Avec les libéraux, et Bourgeois, il avoue sa lassitude des persécutions dont souffre l’Eglise libre. Il souhaite un retour à la normale, juge le combat contre le culte dissident dépassé, tout juste bon à entretenir un sentiment révolutionnaire qui n’a plus lieu d’être. Les difficultés que connaît le canton, d’après lui, exigent un autre comportement. Incapable de supporter l’autoritarisme de Delarageaz, il s’allie à l’opposition de gauche lorsqu’elle critique la gestion de l’administration par le Conseil d’Etat, les faveurs accordées à ses amis. Toujours avec Eytel, et avec les libéraux, il réclame une diminution du nombre des conseillers d’Etat, puis soutient la demande de révision de la Constitution, en 1859. Retourné à la vie économique, il s’engage particulièrement dans le secteur des chemins de fer, dans lesquels, et contrairement à Druey, il a toujours investi de grands espoirs pour l’avenir. Il décède en 1875.
© Olivier Meuwly, Lausanne 2003