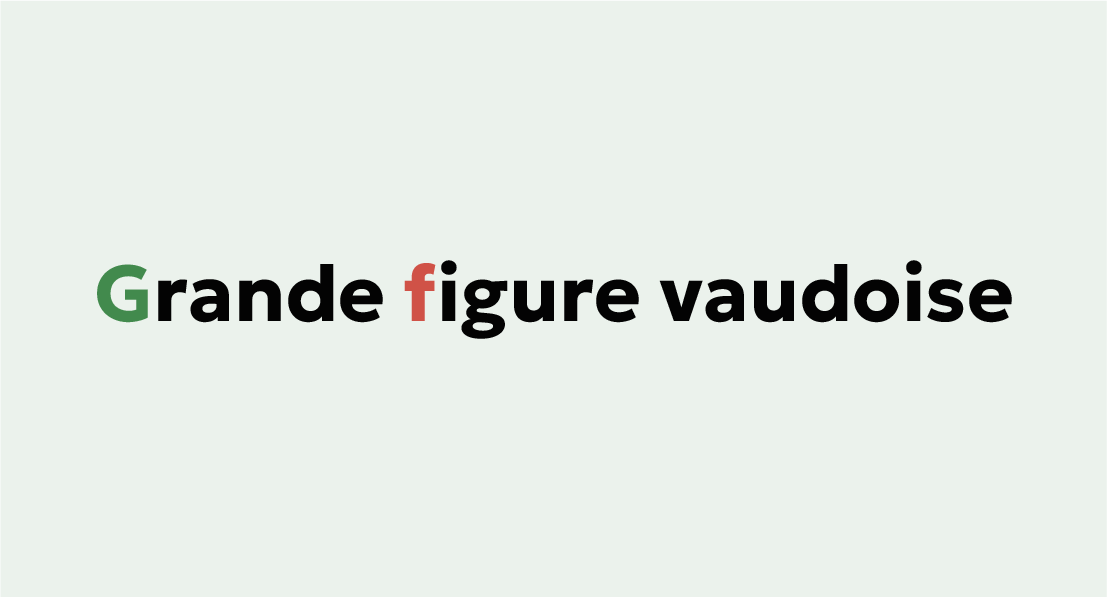
Marc Ruchet (1853-1912)
Grandes figures vaudoises
Né en 1853 à Saint-Saphorin-sur-Morges, mais originaire de Bex, Marc Ruchet accomplit son cursus universitaire à Lausanne, jusqu’à son brevet d’avocat. Membre de la société d’étudiants Helvétia, il fait son stage chez Louis Ruchonnet et le rejoint ensuite comme associé. Dans un tel environnement, il ne peut guère résister à l’appel de la politique. Député en 1882, il préside simultanément le Conseil communal de Lausanne et le Grand Conseil, en 1887. Homme affable, discret, bon technicien, il ne se dérobe pas devant les contraintes politiciennes et sait aussi, dans un parti voué aux luttes intestines récurrentes, s’imposer comme chef de clan, selon les besoins.
Il entre au Conseil d’Etat en 1894 et reprend le Département stratégique de l’instruction publique et des cultes, où s’étaient distingués, avant lui, les Ruffy et Ruchonnet. Président du gouvernement en 1898, il est délégué au Conseil des Etats de 1887 à 1894 et de 1896 à 1899. Comme nombre de notables radicaux, il occupe maints sièges de conseils d’administration du secteur parapublic, comme à la Banque cantonale vaudoise ou à la compagnie de chemins de fer de la Suisse occidentale et du Simplon. Au départ d’Eugène Ruffy, en 1899, le siège vaudois au Conseil fédéral aurait dû revenir à Emile Gaudard, l’un des radicaux les plus influents à Berne. Mais celui-ci déclinant l’invitation, l’unanimité se fait sur la personne de Ruchet, dont le profil rassurant rallie tous les suffrages.
A part 1905 et 1911, où il dirige le Département politique en même temps qu’il préside, selon la coutume, la Confédération, et 1904, où il se retrouve à la tête du Département des finances, il conduit tout au long de son parcours bernois les destinées du Département de l’intérieur. Ce « ministère », pas aussi imposant qu’aujourd’hui, doit néanmoins faire face à des problèmes de plus en plus considérables. Durant le dernier quart du XIXème siècle, le radicalisme gît dans une situation difficile. Longtemps garant de l’équilibre social grâce à un système étatique qu’il a contribué à façonner, il est désormais débordé, tant sur sa droite que sur sa gauche. Sur sa droite, il doit tolérer les tendances séparatistes de la paysannerie, qui estime que le radicalisme s’est excessivement subordonné au capitalisme financier, qu’il a trahi les classes moyennes. Dans le même mouvement, la gauche ouvrière, depuis toujours fidèle au radicalisme, s’autonomise, sensible aux doctrines révolutionnaires et internationalistes. Pour défendre son identité et le type de libéralisme auquel il croit, le radicalisme va alors peaufiner sa vocation réformiste et jeter les bases de ce qui deviendra l’Etat providence, dans lequel se condensent dimension sociale, patriotisme et sauvegarde du droit de propriété.
Mais à la fin du XIXème siècle surgit un nouveau problème, parallèle au précédent dans ses fondements philosophiques et qui va marquer toute la Belle-Epoque, avant de traverser le XXème siècle et s’affirmer, dans le dernier quart du XXème siècle, comme un élément incontournable du débat politique: la question « écologique ». Le capitalisme paraît non seulement déchirer les équilibres sociaux antérieurs, mais également l’harmonie qu’offre la nature inviolable. Nombreux sont alors ceux qui vont attacher une importance croissante à la défense du patrimoine naturel et historique de la Suisse. Alors que se répand une idéologie anti-urbaine, qui idéalise la montagne et les travaux de la campagne, et alors qu’enfle la prise de conscience des dangers que l’industrialisation fait peser sur la santé et l’environnement, se fondent, en 1905, le Heimatschutz, et, en 1907, la Ligue pour la protection de la nature. Les intérêts du tourisme renforceront bientôt ce souci de préservation du paysage helvétique. Le conservatisme protestant sera l’un des propagateurs principaux de ces nouvelles idées.
Comment vont réagir les autorités cantonales et fédérales? Dans le même esprit que face à la question sociale: par un réformisme prudent, dans la quête constante d’une réconciliation entre les intérêts du libéralisme politique et économique, articulés autour du droit de propriété, et ceux de la classe ouvrière, pour la question sociale, et de la nature, pour la question écologique. Le radicalisme, à la pointe du combat hygiéniste, réussira d’ailleurs une sorte de synthèse entre ces deux questions. Tandis que le canton de Vaud promulgue, en 1903, une loi pionnière en Suisse autorisant les autorités à enlever les affiches publicitaires qui entachent le paysage, le Conseil fédéral aligne un certain nombre de lois élargissant ou instituant des protections particulières pour la faune, la nature ou le patrimoine national. Sous la direction de Ruchet, sont votées une loi sur les forêts, une loi augmentant les subsides aux beaux-arts, une loi sur les monuments historiques, l’interdiction de l’absinthe. Dans un autre domaine, Ruchet fera accepter un subventionnement des écoles primaires, concluant ainsi l’épineuse querelle déclenchée par le « bailli scolaire », sous l’ère Ruchonnet. Epuisé et malade, il s’éteint en 1912, alors qu’il envisageait de démissionner bientôt.
© Olivier Meuwly, Lausanne 2003